 L’essence selon Hegel
L’essence selon Hegel
Concepts, enjeux et problèmes de la Logique de l’essence
Tome 87, cahier 3, Juillet-Septembre 2024
Ioanna Bartsidi 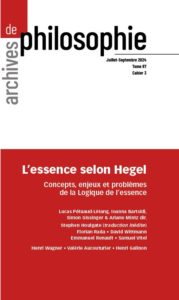 et Simon Gissinger, Avant-propos
et Simon Gissinger, Avant-propos
Stephen Houlgate, L’essence et la forme dans l’Encyclopédie et la Science de la logique. Traduction inédite
Dans la Logique de l’Encyclopédie et la Science de la logique, la doctrine de l’essence est présentée avec une différence importante : la forme, la matière et le contenu sont étudiés en des endroits différents. Si cette logique est immanente, comment peut-il en exister deux versions ? Il n’y a pas là deux logiques alternatives mais une même logique présentée de deux façons différentes. Cependant, la Science de la logique a la priorité car elle explique pourquoi la forme ainsi que d’autres déterminations du fondement, absentes de cette section dans l’Encyclopédie, sont logiquement nécessaires.
Florian Rada, La forme et son extériorisation. Contribution à une relecture de la « diversité » dans la Logique de l’essence
Le concept de forme permet d’analyser la dimension ontologique de la logique hégélienne. Cependant, le processus de détermination, qu’est la forme, n’est pas encore décrit de manière formelle dans la Logique objective, ce qui produit des effets singuliers. On propose de donner un échantillon de ces effets dans la Logique de l’être avant de se concentrer sur le moment d’une extériorisation de la forme, qui se produit dans la diversité (Verschiedenheit) dans la Logique de l’essence. Le rapport entre forme et figure s’y développe d’une manière singulière et permet à la fois d’intégrer la logique dite « formelle » et d’analyser un type d’objectivation spécifique : la variable.
David Wittmann, De l’objectivité de la connaissance à la connaissance des ob-jets
Nous proposons de relire la doctrine de l’essence dans une perspective épistémologique en montrant qu’elle traite de la question de l’objectivité de la connaissance. Les trois réflexions sont autant de manière de thématiser le problème moderne de la connaissance sommée de justifier son objectivité. Hegel va montrer que l’objectivité de la connaissance se mesure à sa capacité à penser des formes d’objets de plus en plus concrets.
Emmanuel Renault, Enjeux logiques et ontologiques du concept hégélien d’effectivité
Cet article s’efforce de distinguer les enjeux ontologiques et logiques de la théorie hégélienne de l’effectivité. Dans un premier temps, il précise en quoi la Science de la logique « coïncide » avec l’ontologie ou la « remplace ». Dans un deuxième temps, il analyse manière dont Hegel présente la Science de sa logique dans son ensemble comme une théorie logique. Il est alors possible, dans un troisième temps, de mieux comprendre se la contribution de la section effectivité à la théorie de la vérité de la pensée.
Samuel Vitel, Y a-t-il quelqu’un qui pense ? La subjectivité logique chez Hegel
Deux tendances d’interprétation de la logique hégélienne se font face aujourd’hui. La première, dite « ontologique », accorde une portée référentielle à celle-ci. La seconde, dite « épistémologique », met l’accent sur la dimension réflexive de la pensée logique et se détourne de la référence au profit de l’auto-examen de la pensée. Si la première semble plus à même de garantir l’objectivité de la pensée logique, elle encourage l’adoption d’une « rhétorique de la passivité », peu à même d’expliquer le mouvement qui anime la logique. L’article propose de rendre compte de ce dernier en mettant en lumière le rôle central que Hegel fait jouer à la subjectivité. Apparaîtra alors que s’il y a, nécessairement, toujours quelqu’un qui pense, la pensée exige en même temps que ce quelqu’un puisse être n’importe qui.
* * *
Henri Wagner, Logique, vérité et descente sémantique
Dans cet essai, nous voudrions contribuer à offrir une compréhension adéquate de l’usage par Quine du prédicat de vérité dans la formulation des lois logiques. L’enjeu est central : puisque la « logique poursuit la vérité dans l’arbre de la grammaire » en généralisant sur des phrases exemplifiant la même structure logique au moyen du prédicat de vérité, commettre un contresens sur ce point, c’est se rendre incapable de comprendre adéquatement la relation interne entre logique et vérité. La méthode adoptée consiste à corriger certaines confusions répandues au sujet de la relation entre logique, vérité et montée sémantique.
Valérie Aucouturier, Bien agir selon Elizabeth Anscombe. Action humaine et vérité pratique
La « vérité pratique », d’après Anscombe, ne vise pas la simple capacité d’agir mais la capacité de bien agir. C’est, écrit Aristote, « la vérité qui s’accorde avec le juste désir ». Anscombe spécifie le point : « La vérité pratique est la vérité produite par une bonne délibération menant à une décision et à une action, et cela inclut la vérité de la description “bien faire”. » Il s’agit ici de saisir la portée éthique de ce concept qui ne vise pas simplement la structure délibérative de l’action intentionnelle, mais la détermination de ce qu’est une bonne action, et plus exactement une bonne action humaine : « La vérité pratique est une vérité créée par l’action au sens où ni les branches, ni les chiens, ni les enfants ne sont capables d’action. »
Henri Galinon, La métaphysique est politique. Nature, liberté et finalité chez Jules Lagneau
Nous proposons dans cet article de revenir de façon synthétique sur l’évolution de la philosophie de la vérité de Putnam. Par-delà le paradoxe apparent de sa fidélité revendiquée à un naturalisme qu’il n’a pourtant cessé de redéfinir en profondeur, notre lecture porte l’accent sur la continuité de l’effort de Putnam pour articuler philosophiquement les normes qui opèrent à l’intérieur de la pensée scientifique, à partir d’une réflexion sur la réalité des relations représentationelles.
* * *
Bulletin leibnizien X
En liminaires :
Le bulletin fête ses 10 ans.
Éditer, lire, interpréter Leibniz : Louis Davillé (1871-1933).
À la suite du cadeau offert par Emmanuel Macron à Angela Merkel, découvertes dans la correspondance entre Leibniz et Charles Irénée Castel de Saint-Pierre.
Étude critique de Dynamica de potentia et legibus naturæ corporeæ. Tentamen scientiæ novæ, Georg Olms Verlag, 2023, volumes I, II.1 et II.2 et recensions.
Bulletin de philosophie du Moyen Âge XXV
En liminaires :
En 2024, le « Bulletin de philosophie médiévale » devient « Bulletin de philosophie du Moyen Âge », il bénéficie d’un rapprochement avec la Journée incipit du Centre Pierre-Abélard (Sorbonne université) et décide d’étendre ses recensions non seulement à 2022 et 2023 mais aussi à l’année en cours.
Editorial
Archives de philosophie publia en 2012 le dossier « Hegel. Science de la logique. Deux siècles après », coordonné par Jean-Marie Lardic. La raison en était double. La première avait à cœur de marquer le bicentenaire de la parution du premier livre de la Science de la logique, intitulé la Logique de l’être dans sa première version. La seconde, de rendre hommage à Pierre-Jean Labarrière et à Gwendoline Jarczyk qui en avaient livré la première traduction française.
Douze ans plus tard, Archives de philosophie publie un dossier sur la Science de la logique, mais consacré cette fois-ci à la Doctrine de l’essence, deuxième livre de la première partie, intitulée Logique objective, de la Science de la logique.
Ce dossier coordonné par Ioanna Bartsidi et Simon Gissinger réunit sous le titre « L’essence selon Hegel. Concepts, enjeux et problèmes de la Logique de l’essence » des articles d’un séminaire de recherche. Il n’est pas dans les usages de la revue de faire paraître des dossiers issus de journées d’études, de colloques ou de séminaires de recherche. La Rédaction a néanmoins, et dans ce cas précis, fait exception.
Car il s’agit ici de travaux qui s’aventurent dans l’une des œuvres les plus difficiles de Hegel. Pour cela, les articles relèvent un double pari : celui de porter au jour le lien si complexe et subtil d’une doctrine de l’essence avec le tout et le mouvement d’ensemble de la philosophie hégélienne, en défrichant des passages inédits entre la phénoménologie de l’esprit et cette doctrine ; celui de faciliter l’accès à la Science de la logique en dégageant des significations, des horizons de réflexions autour de la notion d’essence et de sa fonction, qui en montrent la pertinence aujourd’hui.
Certes Archives de philosophie publie aussi le « Bulletin de littérature hégélienne », dont la renommée n’est plus à faire aussi bien dans le monde francophone que non francophone des spécialistes de Hegel et, au-delà, de l’idéalisme allemand. La revue marque ainsi depuis plus de trente ans sa volonté d’être impliquée dans l’édition de travaux qui enrichissent la recherche hégélienne. Cette volonté rencontre dans l’actuel dossier une ambitieuse et enthousiasmante prolongation de son élan.
La Rédaction
♦ ♦ ♦
